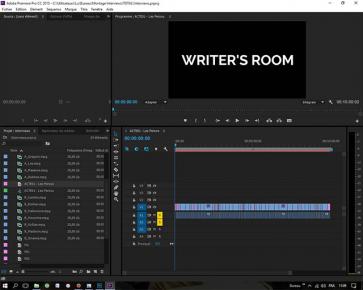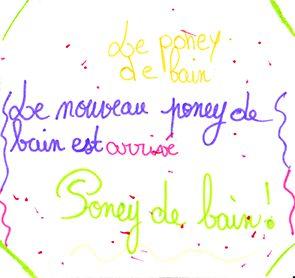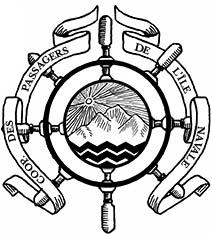Prologue écrit pour la préparation du premier atelier avec les 18 élèves de CM2 de l'école de Châteaumeillant.
Le bateau, ça faisait longtemps qu'il était là. On aurait aimé qu'il ne serve jamais, qu'il reste un « au cas où », qu'il demeure à quai. À quai de montagne. Les scientifiques avaient déjà fait un premier relevé. Un premier constat, un premier avertissement. La mer montait. Alors on a eu peur, mais on n'a rien changé. Question de réflexe. On s'est dit que c'était une affaire de scientifiques, que s'ils nous disaient qu'elle monte, la mer, ils se débrouilleraient bien pour qu'elle redescende. On s'est dit aussi que ça pouvait être dangereux mais que de toute façon, on ne pouvait rien contre la mer, alors il valait mieux faire tout comme d'habitude. C'est meilleur pour la santé. Si le meunier ne peut plus fabriquer de farine, c'est quand le boulanger ne vend plus de pain que l'on commence à s'inquiéter. On a juste attendu de ne pas avoir le choix, en quelque sorte. Il a suffi d'une seule goutte pour faire déborder la mer jusqu'au pied de notre montagne. C'était comme si elle avait collectionné tous les cailloux qu'on lui avait un jour jetés pour se venger d'un coup, en une seule grosse fois. Les scientifiques qui restaient avaient tout un tas de théories pour expliquer le désastre. Je pense surtout que la mer, elle n'en pouvait plus, que quelqu'un y avait lancé le galet de trop. D'un seul coup de sang, elle a rasé les villages de la plaine et les quelques survivants ont commencé à grimper notre montagne. Pour eux, elle n'existait que pour cela, la montagne, pour fuir la gueule béante de l'océan. La montagne leur fit de la place. Ils durent s'habituer à regarder vers le bas – quand on est en altitude, au-dessus, il n'y a plus que le ciel. Certains d'ailleurs ne faisaient plus que ça. Dans leur sommeil, la mer montait toujours. Au lever du jour, nous ne pouvions que confirmer leurs cauchemars. Indéniablement, le niveau des eaux augmentait. La violence et la surprise étaient devenues inutiles, à présent la mer léchait doucement les flancs de la montagne et ce qui montait petit à petit, c'était la solide conviction qu'elle ne s'arrêterait pas avant de l'avoir avalée. Qui venait de la plaine et qui de la montagne n'avait plus de sens. Il ne restait plus qu'un camp, ceux qui avaient encore les pieds au-dessus de l'eau. Et ce camp devait prendre une décision. On fit des tas de réunions. On en sortait avec de la colère ou bien sans rien, avec des bouts d'espoir ou bien d'oubli, jusqu'à ce qu'un jour, on en sortit avec l'idée du bateau. C'était la seule idée assez immense pour marcher. On ne combat pas la mer avec de la réalité, il faut voir plus loin. L'idée du bateau n'appartenait à personne, c'est comme si on y était tous arrivé en même temps. À ce moment, chacun est devenu tout le monde. On arrivait maintenant à regarder vers le haut. Et à la place du ciel, on voyait le bateau. Comme toutes les grandes idées, le bateau s'est construit petit bout par petit bout. Et maison par maison, on a réussi à mettre tout le village dedans. Il allait devenir le plus grand vaisseau du monde. Chacun a aménagé son temps, ceux qui avaient la force de construire le faisaient quatre jours par semaine et consacraient le reste à mener la vie qu'ils menaient avant. Du lundi au mardi, le boulanger faisait son pain, il sciait des planches du jeudi au dimanche – s'il avait choisi le mercredi pour se reposer. Autant dire que pour l'acheter, le pain, il fallait s'adapter. Que l'on s'adapte ou que l'on vive sans pain, on comprenait. On vivait tous un peu comme le boulanger. Les jeunes et les vieux, trop faibles pour participer au chantier, faisaient tout ce qu'on n'avait plus le temps de faire. On comprit que le plan était le bon quand le chantier alla plus vite que la mer. Deux fois plus vite : en vingt ans, le bateau, on l'avait achevé. La mer en mit vingt de plus pour l'atteindre. Durant ces deux décennies, il n'y avait soudain plus rien à faire et on eut tellement de temps qu'on se reprit à espérer. Espérer que le navire reste là, au sommet de la montagne, que la mer, impressionnée par la folie de notre idée, renoncerait et nous saluerait, conquise, avant de se retirer. Mais la mer est inexorable. Notre navire aussi. Il tiendra. Les vagues atteignent la ligne de flottaison, elles arracheront bientôt le bateau de ma montagne. Je leur fais signe de la main, mon domaine n'est presque plus qu'un récif et je suis si vieux que je ne saurais cesser d'en faire partie. Je n'ai de toute façon pas besoin d'essayer pour savoir que j'ai le mal de mer.