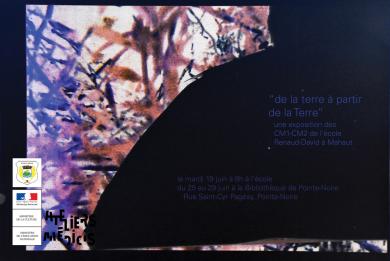Ce que j’ai remarqué, lorsque je suis arrivée, et en premier lieu, ont été les infrastructures françaises implantées sur tout le territoire. Les mêmes routes, panneaux et signalisations auxquels l’Hexagone m’a habituée. Les premiers temps, j’ai d’ailleurs calqué mes habitudes de vie en métropole, en les surjouant presque, le fait de les emporter avec moi m’aidant à m’adapter.
Quand on a l’habitude des trajets fréquents, des distances courtes, des changements rapides, des journées ordonnées et séquencées, on se laisse croire qu’il sera possible de reprendre ce rythme ; aussi pour se rassurer par rapport au fait qu’on va passer cinq mois sur un territoire insulaire, qui apparaît riche, mais d’une richesse difficile d’accès, presque indomptable.
En arrivant, j’ai beaucoup écrit, dans la continuité de textes et de poèmes dont j’avais entrepris une série un ou deux mois avant mon départ. J’ai apporté mes mots, mes expressions et mes rythmes de phrases. Au milieu de la résidence, ou un peu avant, j’ai du faire un aller-retour à Paris, d’autant plus intense que j’y suis restée à peine une semaine. En revenant, je me suis sentie plus dépaysée que deux mois plus tôt. Je revenais en territoire connu, mais cette fois, comme si j’étais enfin prête à me confronter à la difficulté du lâcher-prise, du laisser aller ; comme si cette fois, l’entrée ne m’était pas naturelle, qu’il fallait franchir une barrière.
J’avais déjà commencé à questionner les habitants sur leur rapport à la Guadeloupe, à la politique, aux questions d’indépendance. Cette fois, je me suis mise à apprendre le créole, par le biais d’une rencontre avec un stagiaire métropolitain bien décidé à devenir bilingue. Les rencontres se sont enchaînées, ainsi que la prise de contact avec la DAC Guadeloupe. Ainsi, des points de vues de personnes nouvellement familières se sont multipliés. Des personnes blanches comme noires, implantées là ou de passage, travaillant, ou pas, dans le milieu culturel.
En prenant mes marques, en évoluant parmi des personnes plus familières cette fois, j’ai alors pris conscience de l’accumulation de petites différences – restées jusque là en sommeil – émergeant à travers le filet français jeté sur le territoire. Une manière de s’adresser : une alternance du “vous” et du “tu” marquant à la fois l’attention et le respect, selon les situations. L’omniprésence du don malgré le coût de la vie, même envers ceux qu’on connaît moins, ces dons étant généralement des mets, ou de nature alimentaire. Une présence parallèle de forte solidarité, de discussions entreprises au coin d’une rue qui s’achèvent comme si elles étaient destinées à reprendre sous peu, et de méfiance envers le nouvel arrivant (auquel on m’assimile souvent, n’ayant ni l’accent, ni le moindre bronzage). Aussi, des restes de déférence, difficiles à accepter, datant de l’époque coloniale, couplés à la méfiance précitée. Il semble qu’ici, beaucoup ne puissent pas considérer que je vienne pour travailler sur le territoire autrement que dans le social – on me demande souvent si je suis infirmière ou maîtresse d’école quand j’annonce que je suis venue pour six mois – comme si les spécificités de cette ancienne colonie se devaient d’être oubliées, ou qu’elles étaient trop complexes à aborder, ou encore trop évidentes pour qu’elles nécessitent un échange de plus. Parfois, dans un élan, elles se révèlent, mais les choses retombent vite et de façon convenue, comme par accord mutuel.
Il m’est devenu ardu d’écrire avec mes mots parisiens, ceux que je possédais avant de découvrir ce quotidien qui, sous ses allures de similarité, est si différent. J’ai alors pris les horaires locaux, m’y suis faite ; l’intonation qui malgré moi m’a imprégnée, une sorte de lenteur sur les avant-dernières syllabes ; un état actif prenant l’allure d’une décontraction dans les gestes. Ces dernières semaines, j’ai beaucoup observé, comme en préparation d’une nouvelle façon d’écrire, en gestation d’un nouveau vocabulaire ; et surtout, j’ai cuisiné. C’est aussi la venue d’un ami parisien qui a fait surgir à mes yeux cette différence de goût, ce sucré-salé riche dont la note achève tous les plats, et que seuls la répétition, l’apprentissage intense d’une certaine manière de cuisiner, permettraient d’obtenir ; et qui pourrait déboucher sur une manière d’écrire, de sentir et de voir.
Il y a une forme de répétition laborieuse qui accompagne le quotidien ici. La vie est chère, les horaires lourds, le travail souvent manuel s’étendant de sept à dix-sept ou dix-huit heures. Beaucoup triment, et cette façon de cuisiner qui s’installe dans ces boucles de gestes, ces rythmes qui sous-tendent les airs de kompa ou de zouk et qui les lient, sont empreints d’une énergie qui tire, qui pousse, qui empêche l’état statique, tout cela semble entourer, guider et soutenir des jours parfois à bout de force. Ceci, qu’on aie, ou non, en tête un but à ces allers-venues incessants. Et dans la musique, comme dans d’autres domaines, ce que pourrait masquer une façade commerciale et convenue, presque écœurante, révèle des airs subtils, ou du moins très parlants.
L’autre jour, j’ai dit à un ami que je sentais le temps venu pour moi d’achever mon travail ici et de repartir, les bras chargés du poids des découvertes. Ce sentiment s’est accentué lorsque pour la première fois, j’ai réellement pris conscience du fait que jamais je n’avais vu les arbres nus, mais toujours verdoyants, en éternel été. Le temps m’a alors semblé circulaire, comme l’île, comme si j’avais mis en pause quelques instants le déroulé d’une vie, et il m’a semblé devoir urgemment quitter ce cercle. Mais, quelques jours après, les arbres ont fleuri, et le temps a repris sa linéarité, et encore une fois je me suis sentie dépaysée, découvrant une nouvelle strate de la Guadeloupe, jusqu’ici en sommeil. Par la suite, des fleurs sont apparues presque de nulle part, sur les rochers en forêt, accompagnées de mousses aux textures surprenantes, et, point culminant, on m’a parlé de la Dominique voisine où je n’ai pu me rendre, me détaillant ses cascades, ses sols imprégnés de lave durcie, et sa végétation. Comme si, sur le point de partir, je me retrouvais très loin, beaucoup plus que je ne pensais l’être en arrivant, au tout début ; comme si l’immersion avait été progressive, et d’autant plus mémorable.