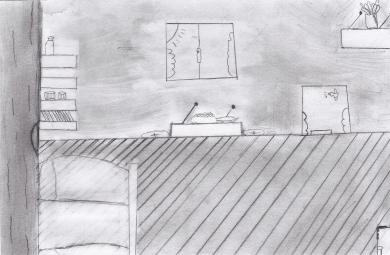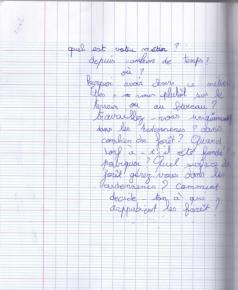Poétique des sous-bois
A l'ère numérique, les outils ne manquent pas pour partager des stories. Mais s'ils venaient un jour à dysfonctionner, à manquer ? C'est sous ce postulat de crise technologique que nous mèneront notre atelier, à l'ombre des bois.
Lieux historiques de refuge collectif ou individuel, les forêts ont depuis toujours accueilli des hors-la-loi en tout genre, des ermites, des animaux sauvages, mais aussi des créatures merveilleuses... C'est du moins ce que nous transmet la littérature : des mythes fondateurs aux récits contemporains, les espaces sylvestres entremêlent sans cesse réel et fiction.
Après avoir mis en commun des légendes, des récits historiques, des anecdotes et observations personnelles émanant d'une forêt voisine, il s'agira de recréer de nouvelles histoires et de se les transmettre. D'un groupe à l'autre, elles circuleront par voie orale, par jeux de pistes et chasses aux mots, pour aboutir à de nouveaux récits, qui pourront à leur tour être transmis et transformés.
Après avoir séjourné en Amazonie puis en Casamance, je suis rentrée chez moi avec l'esprit peuplé de savoirs et de légendes sylvestres qui ne m'appartenaient pas. J'ai cherché à porter la même attention aux forêts autour de moi, et me suis rapidement frottée à une actualité de territoires en lutte, faisant écho à des mouvements d'occupation et de résistances plus anciens. L'histoire politique, économique et sociale ayant fortement conditionné la géographie des forêts actuelles, il s'agissait d'en prendre pleinement conscience pour appréhender correctement ces espaces. Il s'agissait aussi de constater à quel point la littérature s'était faite le reflet et le vecteur de ces évolutions, entremêlant strates historiques et légendaires, réalités factuelles et éléments de fiction.
L'époque médiévale, qui a vu émerger les premiers romans en langue vernaculaire, en a été la matrice : si les bestiaires juxtaposaient animaux réels et mythologiques sans distinction ontologique, la littérature a elle aussi très librement fusionné légendes antiques, chrétiennes et populaires, pour faire se croiser dans les bois des créatures merveilleuses, des chevaliers, des ermites, des hors-la-loi. On retrouve d'ailleurs cette marginalité dans son étymologie-même : de foris, « en dehors ». Cette mixité semble avoir imprégné durablement notre vision de la forêt comme étant un lieu séparé, un espace autre ou hétérotopie foucaldienne, qui « a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles. »
C'est cette hybridité constitutive et ce potentiel fictionnel que je désire explorer, via :
1) Une attention poétique portée à l'environnement, qui passe par les sens, mais aussi par le langage de ses usagers : apprendre les mots adéquats pour parler de réalités précises, et apprécier leurs sonorités – qu'est-ce que le houppier, la canopée, la frondaison ? Que signifie aoûter, débourrer, essarter ? A quoi reconnait-on une frayure ?
2) Une enquête documentaire visant à recueillir des histoires locales, réelles ou légendaires : car la notion d'espace implique un rapport subjectif à un lieu, il s'agira de fouiller les strates mémorielles qui le jalonnent.
3) La création de nouveaux récits, à l'aune des immersions concrètes et symboliques dans la forêt en question, mais aussi de préoccupations contemporaines.
4) Une transmission à la fois orale et matérielle : histoires chuchotées, tracts poétiques passés sous le manteau, herbiers contés... comment recréer des pratiques qui se passent du numérique ?
Ce dernier point, s'il peut apparaître comme passéiste, ne va pas contre les outils actuels, indéniablement pourvus de qualités pratiques, ludiques et éducatives. Il s'agit plutôt de se positionner pour la permanence d'autres usages, plus anciens et peut-être plus durables, moins dépendants d'un apport technologique extérieur. Sans idéalisme ni prosélytisme, la sobriété que je propose dans le cadre de ce projet va dans le sens d'une créativité simple et féconde. Je défends avec énergie les pratiques orales de la littérature, qui peuvent être des temps de partage d'une rare intensité.
Mon choix de terrain a aussi à voir avec une idée de résistance. En résonance avec les propos de l'anthropologue Anna Tsing dans son essai Le champignon de la fin du monde – enquête prolixe et ramifiée sur les champignons matsutake qui poussent dans les vestiges des forêts industrielles de l’Oregon –, je ressens, face aux effondrements présents et à venir, une nécessité vitale à sortir des discours dominants qui les ont engendré. Si la forêt a le vent en poupe dans les discours, les publications et le milieu culturel aujourd'hui, je crois qu'une approche plus directe demeure nécessaire à chacun.e pour en comprendre les enjeux et en ramener des récits plus authentiques. Enfant, je n'ai pas eu la chance d'être initiée au milieu sylvestre : je souhaite rattraper le retard aujourd'hui en tant qu'adulte, et transmettre cette expérience aux futur.e.s acteurs et actrices de ce monde.
Cela passera donc par une immersion physique, mais aussi littéraire. Prenons l'exemple des Ardennes : plusieurs fictions s'y font écho, de la Chanson des Quatre fils Aymon à la pièce Zone à étendre de Mariette Navarro, en passant par Comme il vous plaira de Shakespeare et Un Balcon en forêt de Julien Gracq – et nul doute que la littérature locale regorge d'autres récits. L'intertextualité dans les espaces sylvestres et l'influence des fictions sur notre perception font l'objet des recherches théoriques que je développe en parallèle de ma pratique d'écriture.
Le projet aboutissant à des lectures, mais aussi à des objets éditoriaux, j'aimerais que les textes créés deviennent une sorte de nouvelle archive locale, qui pourrait par la suite être lue, réinterprétée et complétée par d'autres. Comme le Dossier sauvage de l'historien Philippe Artières, il s'agira de rassembler des récits qui constitueraient une banque de données fictionnelles, vouées à documenter notre forêt. La part d'investigation, que je prolongerai par des explorations et des entretiens plus poussés avec des personnes ayant des liens avec cette forêt par leur métier ou leur trajectoire individuelle, me permettra aussi de collecter une matière textuelle vivace qui servira de point de départ à un nouveau projet d'écriture personnel.
Par cette nouvelle entrée dans les bois, je souhaite réactiver collectivement nos imaginaires sylvestres, en remettant en circulation un vocabulaire précis et poétique. C'est une sensibilisation à l'environnement par la littérature, son épaisseur mémorielle, son pouvoir d'évocation : autant d'armes langagières pour défendre nos forêts.
Journal du projet :
Par le(s) artiste(s)