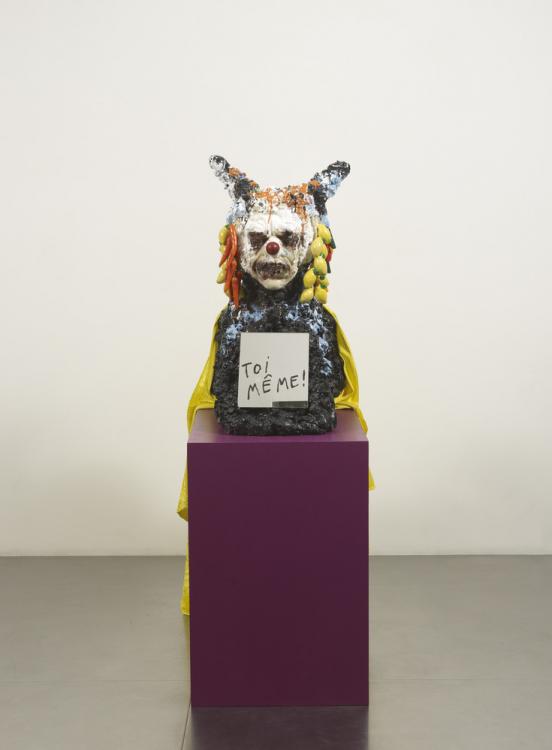
Hiver 1709. Changement d'État
La docu-fiction radiophonique "Hiver 1709. Changement d’État" propose une écriture alternative de l’Histoire et des sciences sociales, via un renouvellement du récit de crise, et la création d'opérations historiographiques nouvelles et purement sonores.
À l’heure des fake news, d’une crise sanitaire mondiale, et d'une situation environnementale alarmante : qu’est-ce qu’une docu-fiction radiophonique historiquement informée sur l'Hiver 1709, et quelle(s) histoire(s) devons-nous collecter pour le raconter ? "Hiver 1709. Changement d’État" propose à des classes primaires en REP et situées dans la couronne parisienne de faire un plongeon dans une crise non pas du trop chaud mais du trop froid, en plein Hiver 1709, pour y faire refléter les crises de leur présent et donner matière à penser.
C'est dans l’environnement social du Grand Paris, le Paris d'aujourd'hui avec ses nouvelles inégalités que cette docu-fiction construira ce récit de crise.
Écoutez le podcast Hiver 1709. Changement d'État. LE LABO, fruit de la résidence Création en cours #6
Si Arlette Farge nous dit que l’historien "réemploie des formes existantes, appliquée à les réajuster autrement pour rendre possible une autre narration du réel", alors comment employer les formes existantes de notre actualité afin de construire en 2021 une narration du réel de l’hiver 1709 ? Voici la question centrale de ce projet et, il s'agira dans le processus de création au sein des Ateliers Médicis, de réfléchir avec des classes de primaire à une écriture de l'histoire - je dirais même de "leur" histoire.
Si tout liquide se solidifie pour devenir glace dans ce paysage de 1709, les personnages eux aussi changent d’état. C’est d’abord des voix qui mutent : Benjamin en pleine "éducation politique" et en pleine puberté a sa voix qui mue ; Jeanne a la voix grave et tremblante d’une femme sage toujours hantée par le doute ; Eugénie a celle du complotiste aux scansions chamaniques qui abrutit et hypnotise ; et Claude quitte sa voix de femme pour une voix d’homme. Autant de personnages qui ne pouvaient trouver un échos que dans un "casting de rue". Cette fiction sonore sera celle d’un enfant en puberté, celle d’une femme âgée solitaire, ou encore celle d’un transe en pleine transition FtM (Female-to-Male). À l’ère où seul le changement conceptuel existe (en écologie, changement climatique ; en politique : "le changement c’est maintenant"…), cette fiction captera ces voix en pleine mutation. D’épisode en épisode, ces voix en pleine métamorphose dessineront les voix d’un changement d’état. À l’opposé de l’utilisation politique actuelle du terme "changement", ces personnages redonneront chair au mot. La totalité du script sera enregistrée à plusieurs moments de leur mutation vocale, puis les pistes seront sélectionnées pour mettre en lumière la modulation progressive des voix. Une authenticité dans la voix, ou encore, la voix comme geste émancipateur seront ici recherchés...
Mais notre quête d’un dispositif du réel ne s’arrête pas là. S’inspirant d’écritures mises en place au cinéma comme dans La pointe courte d’Agnès Varda par exemple, Hiver 1709. Changement d’État juxtaposera à la fiction un tissu d'inspiration documentaire. En plus de l’enregistrement du script proprement fictionnel, l’environnement social sera en partie issu d’enregistrements réalisés sur le terrain en 2021, qui (malheureusement) se prête magnifiquement à notre crise 1709, compte tenu de la crise sanitaire. Garder trace de notre contemporain et l’utiliser pour nourrir ma "narration du réel" de 1709, ou encore développer une démarche sociologique pour nourrir mon tableau socio-culturel de l’hiver 1709 : voici ma démarche pour réaliser cette docu-fiction sonore. Ainsi, je fais appel aux Ateliers Médicis afin de mener ce travail de terrain, et donner à entendre un groupe social central dans la docu-fiction : les "enfants dans la ville au XVIIIe siècle". Certaines activités durant les temps de transmission seront enregistrées afin de dresser le tableau des "enfants de la ville" de 2021, les "enfants en REP". C'est pourquoi cette résidence au sein des Ateliers Médicis est cruciale pour mener à bien ce projet. Elle permettra de m'offrir un terrain sociologique absolument nécessaire pour réaliser cette docu-fiction.
Ce dispositif du réel se fera aussi par une recherche du paysage sonore de l'hiver 1709. Retrouver la musique de cette nature gelée et paralysée par le froid : axe de recherche que je mènerai avec Aline Pénitot, compositrice électro-acoustique et documentariste radio qui a déjà bravé le froid lors de ses courageuses expéditions au Pôle. Ce travail se sera d’abord une investigation scientifique pour tenter de donner à entendre l’environnement sonore de cette crise qui gèle la France de 1709. Mais cette recherche se fera aussi dans une dynamique artistique. Le froid n’est pas une thématique nouvelle pour la composition musicale. Nous n’échapperons pas à cette riche thématique sonore et l’articulerons avec la trame narrative. C’est d’abord dans la voix que le froid et toutes ses métaphores se feront entendre : le froid qui fige, fixe, paralyse mais aussi celui qui fait trembler. La voix du tremblement, c’est métaphoriquement celle d’un Monde qui "se créolise" pour reprendre les mots du philosophe de la "pensée du tremblement", Édouard Glissant. "Le tremblement est la qualité même de ce qui s’oppose à la brutale univoque raide pensée du moi hormis l’autre." Voix du tremblement, c’est donc celle du doute mais aussi de la peur qui nous dépossèdent du contrôle de nos cordes vocales. En échos à une météorologie où "température ressentie" a le vent en poupe, le froid ne sera pas uniquement l'élément sonore d’un paysage mais aussi incarné vocalement. Le projet tâchera d'initier les classes de primaire à ce travail scientifique d’anthropologie du paysage sonore du XVIIIe siècle, mais aussi à chercher une "énonciation" du froid (discours paralysé, tremblant...).
Enfin, la musique baroque, la musique contemporaine de 1709 sera aussi au rendez-vous dans ce tableau sonore. C’est un ingrédient qui ne pourrait être oublié. C’est l’occasion d’entendre tout à fait autrement ce répertoire, lire entre les portées pour y entendre peut-être le chaos de ces années de famine et de peur collective, ou au contraire, le chant de l’espoir. La musique ancienne sera principalement insérée de deux manières.
Une première où la musique sera au préalable disséquée, décomposée. Ensuite, tout comme le maître du pointillisme, Paul Signac, nous insérerons les couleurs de la musique ancienne par petits points dans notre tableau. Par la prise de distance inhérente à la position d’écoute et par la puissance de la forme, la musique jouée sera reconnue. L’auditeur reconstruira intuitivement le puzzle musical. Ce travail de destruction et d'agencement du matériau musical, c'est celui que nous explorerons lors de notre résidence à la Fondation Royaumont.
Une deuxième manière s’appuiera sur la fonction sociale ou symbolique de l’œuvre choisie : par exemple, l’ouverture à la française majestueuse, noble et théâtrale, sorte de "pépite du soft power" utilisée par Louis XIV pour légitimer à travers la puissance sonore de cette forme musicale, la froideur artificielle et stratégiquement construite d’une politique sans pitié ; et qui contraste avec la froideur "naturelle" du paysage sonore qu’affrontent Benjamin, Eugénie et Claude.
Les rencontres musicales avec les classes de primaire permettront de sensibiliser les plus jeunes à un répertoire souvent méconnu, mais également à découvrir et à entendre les instruments dits "anciens". Leur regard extérieur me permettra de développer une nouvelle écriture de la musicologie par l'écoute.
Plus largement, ces ateliers permettront à des jeunes d'être acteurs d'un projet radiophonique, au croisement entre arts et sciences sociales. Ils permettront la rencontre d'artistes et scientifiques : musicien.ne.s, compositeur, historien.ne, archiviste, ingénieur.e du son...
